

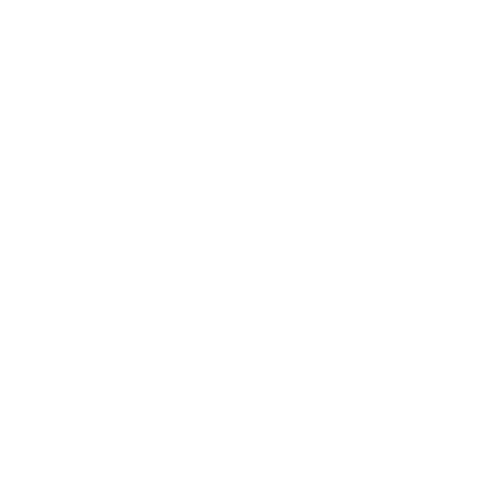 Publications
Publications
L’Union régionale des plateformes de services à la personne d’Ile-de-France (Ursap-IDF), soutenue par la Direction régionale des entreprises, de concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (Direccte-IDF) ont décidé de mettre en place un baromètre social pour mieux connaître les conditions de travail des salarié.e.s des services à la personne ainsi que leurs besoins en termes de professionnalisation.
Les résultats de ce baromètre démontrent que les intervenant.e.s portent un regard largement positif sur leur métier, rémunération exceptée (62% des salariés estiment que leur travail n’est pas rémunéré à sa juste valeur). Cette profession comporte une forte dimension relationnelle et ne peut se réduire à des taches de ménages ou d’exécution. La majorité des résultats du baromètre vont ainsi à l’encontre de certaines idées reçues sur les services à la personne. Les réponses dessinent un secteur encore jeune qui comporte certes des conditions de travail difficiles mais qui est aussi en pleine mutation et professionnalisation. Les salariés se déclarent plutôt satisfaits de leur rythme de travail, des relations avec leur hiérarchie, du contenu et de l’organisation de leurs tâches et estiment exercer un métier utile et porteur de sens.
75% des intervenant.e.s n’ont qu’un seul employeur, 79% estiment suffisant le nombre d’heures de travail fourni par leur structure : un quart seulement travaillent moins de 20 heures par semaine, et 45% plus de 30 heures ;
pour 74% des intervenant.e.s, l’organisation du travail leur permet de trouver un bon équilibre avec leur vie personnelle.
96% des intervenant.e.s trouvent du sens et se sentent utiles ; 88% déclarent pouvoir faire un travail de qualité ;
76% se sentent écoutées par leur responsable au sujet de leurs problèmes de travail et 97% disent avoir une relation de confiance avec leur direction.
93% sont satisfaites par la définition de leurs missions et 84% déclarent disposer d’un temps suffisant pour les réaliser.
44% des intervenant.e.s n’ont aucune qualification professionnelle. Mais elles sont 71% à déclarer que leur structure leur permet de se former.
Pour 75% des intervenant.e.s et 78% de l’encadrement, le travail peut être éprouvant sur le plan émotionnel (décès, dégradation de l’état de santé des usagers) comme le sont toutes les professions comportant une forte dimension relationnelle.
Près de 40% des intervenant.e.s ont plus de 50 ans et effectuent un travail souvent pénible (position accroupie, debout…) où les risques ne sont pas toujours bien identifiés et maitrisés. La sinistralité du métier est d’ailleurs assez proche de celle de secteurs comme le bâtiment.
Les intervenant.e.s peuvent subir des agressions : 9% souvent et 20% parfois, 29% disent en subir souvent ou parfois, sachant que certaines de ces agressions sont souvent liées à la pathologie de l’usager.
Enfin 31% des intervenant.e.s déclarent ne pas se sentir capables physiquement et moralement de « faire ce travail pendant de nombreuses années » ; 33% disent être presque toujours ou régulièrement épuisées par leur travail. Ce qui pose à moyen terme, la question du maintien dans l’emploi pour une intervenante sur trois.
